
Avec 41 % des espèces menacées, les amphibiens subissent un déclin alarmant, dû à l’urbanisation, aux espèces invasives et au réchauffement climatique. Des efforts de préservation, comme la réintroduction de la rainette verte en Wallonie, sont en cours.
Les amphibiens connaissent un déclin très marqué à l’échelle de la planète. Avec 41% d’espèces menacées, les amphibiens sont la classe d’animaux vertébrés à l’avenir le plus incertain. Pour donner une idée, les chiffres correspondants pour les mammifères et les oiseaux sont respectivement de 26% et 12%.
Quelles sont les principales menaces qui pèsent sur ces animaux ?
Il y en a plusieurs : fragmentation de leurs habitats, voûtement de cours d’eau, raréfaction de leurs biotopes aquatiques.
En raison de l’urbanisation croissante et du développement des activités humaines , les amphibiens ont connu des régressions importantes.
C’est pourquoi, depuis, plusieurs années, les efforts de préservation de ces espèces portent sur la restauration de leurs milieux.
Aménagement de mares, reconnexion de zones humides entre elles, remise à ciel ouvert de cours d’eau là où c'est possible.
Et puis, il y a des efforts spécifiques sur des espèces assez rares, comme la rainette verte. Cette espèce a été réintroduite en Wallonie en 2022 et 2023 … et l’espèce a commencé à se reproduire en 2024, une première en 40 ans !
Cela dit, la principale inquiétude de nos jours concerne des espèces communes : la grenouille rousse et le crapaud commun.
Les propriétaires ruraux ont constaté une évolution radicale depuis quelques années. Dans certains points d’eau où ça coassait abondamment il y a 6 ou 7 ans, aujourd’hui, quasi plus rien. Inquiétant !
Les causes sont multifactorielles.
La grenouille rousse est bien adaptée à un climat assez frais, le réchauffement global lui pose des problèmes. Il y a aussi la prédation par des espèces exotiques envahissantes comme le raton-laveur. En période de reproduction lors des rassemblements de grenouilles adultes, ce peut être un carnage à certains endroits !
Enfin, il y a des pathogènes. Par exemple, un champignon (au terme scientifique quasi imprononçable 😉) décime les populations de salamandres en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne. Lorsqu’une population est infectée par ce champignon, presque tous les adultes meurent en quelques semaines.
Face à ces constats assez effrayants, que peut-on faire à notre niveau pour endiguer ce phénomène ?
Les auditeurs qui le désirent peuvent prêter main forte aux groupes de volontaires qui viennent en aide chaque année aux amphibiens : à la période de reproduction, ils les aident à traverser les routes, ce qui permet aux amphibiens d’aller rejoindre leur zone de ponte (mare, étang, …) en sécurité.
La reproduction s’étale de mi-février à début avril, en fonction des conditions météo. À cette période, lorsqu’il fait humide et que les températures en soirée tournent autour de 8°, des mouvements peuvent démarrer. Plein d’infos utiles se trouvent sur le site de NATAGORA
On peut aussi aménager une petite mare dans son jardin ou au sein d’un jardin partagé, on trouve des conseils sur le net.
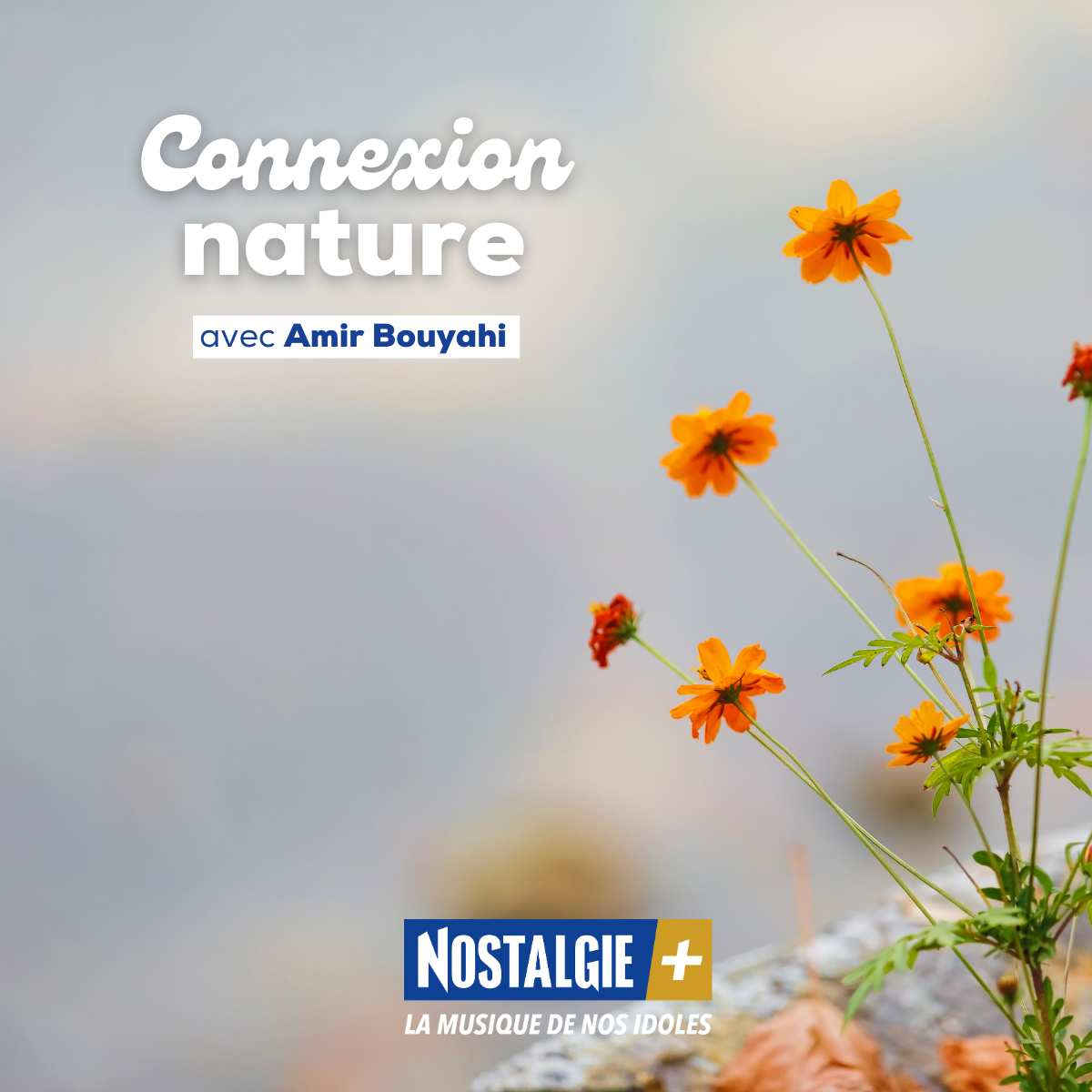
Chaque semaine, Amir Bouyahi de « Connexion Nature » nous parle du monde vivant qui nous entoure. Découvrez comment la nature évolue, comment la préserver et l'observer.
