
Plantes non semées qui s'invitent dans nos jardins, les mauvaises herbes — ou herbes "folles" — ont mauvaise réputation. Pourtant, ces plantes sauvages comme le pissenlit, l'ortie ou la ronce sont riches en vertus médicinales, nutritives et écologiques.
De nos jours certains préfèrent parler d’herbes « folles », est-ce vraiment mieux ? Pas certain. On parle aussi de plantes « adventices ».
Pour commencer, quelle définition donner aux mauvaises herbes ?
Il s’agit de plantes sauvages qui poussent spontanément à un endroit sans y avoir été « invitées » par l’être humain 😉, c’est -à -dire sans semi ni plantation. Conséquence : ces plantes entrent en concurrence pour l’eau avec les plantes cultivées. Par ailleurs, elles ont une croissance assez rapide, elles occupent donc rapidement un espace au détriment d’autres.
Si on s’interroge sur les prémices du concept de mauvaises herbes, on se rend compte que ça remonte aux débuts de l’agriculture.
Exactement, il y a environ 10.000 ans. Avant cela, les humains consommaient des plantes sauvages. Puis ils se sont mis à cultiver certaines plantes spécifiques pour les manger. Du coup, les plantes sauvages non désirées sont devenues « mauvaises » par opposition aux « bonnes » que l’être humain souhaitait cultiver ou planter à un endroit donné.
Beaucoup de mauvaises herbes sont comestibles et/ou possèdent des vertus médicinales.
En plus, les plantes sauvages sont le plus souvent bioindicatrices.
Leur présence parfois massive peut donner au jardinier de précieuses indications sur le caractère trop compacté d’un sol ou sur un excès de matières végétales en décomposition par rapport aux microorganismes présents dans le sol.
Par exemple, l’ortie indique un sol riche en azote et en matière organique.
Le plantain indique un sol compacté et piétiné.
Malgré tous ces attraits, si l’on ne fait rien, ce sont les plantes sauvages qui risquent de dominer une parcelle cultivée.
Oui car les plantes sauvages poussent et se dispersent souvent plus vite que les plantes cultivées et elles sont plus résistantes aux maladies.
Nous verrons ensemble dans la 2ème partie de cette chronique comment gérer cela au mieux.
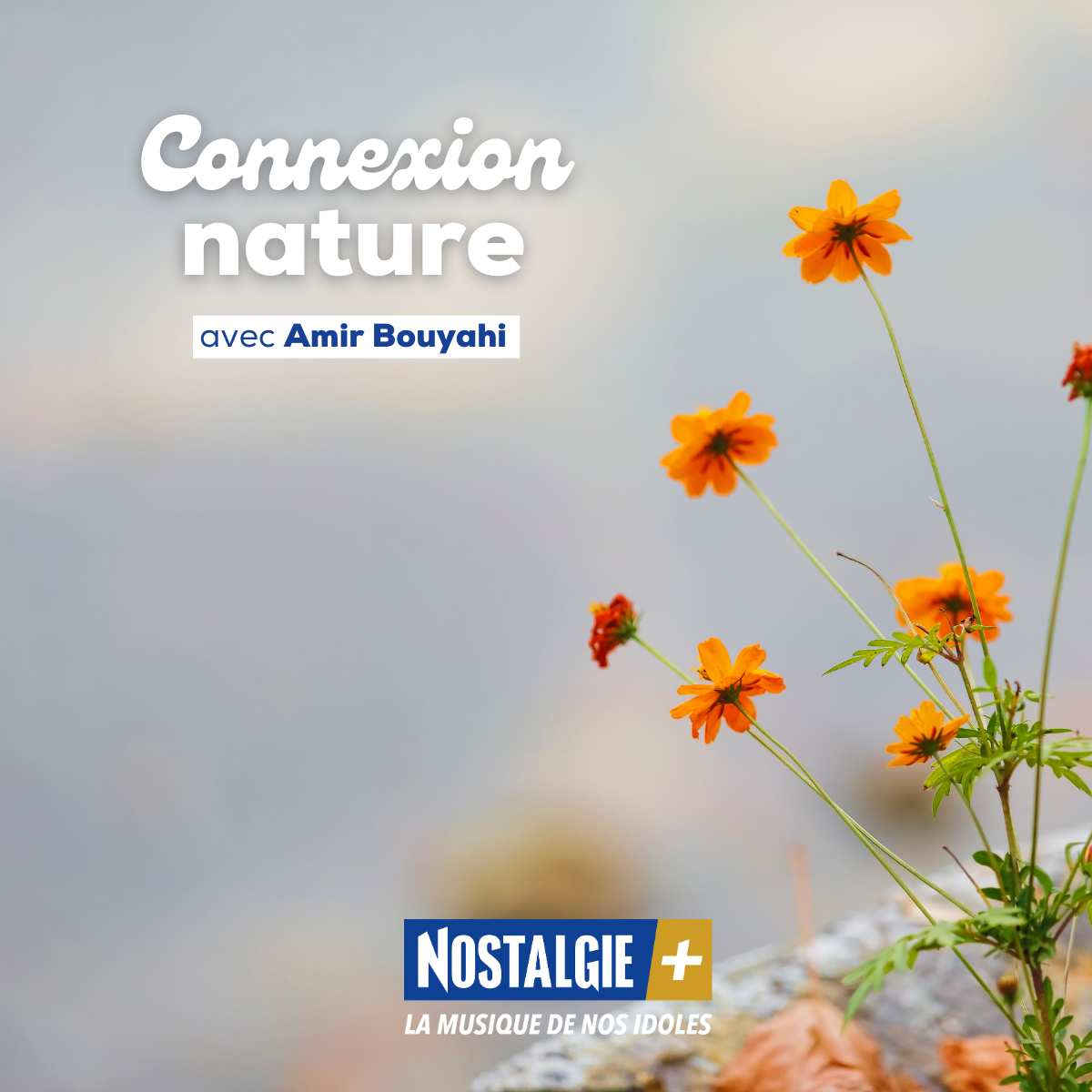
Chaque semaine, Amir Bouyahi de « Connexion Nature » nous parle du monde vivant qui nous entoure. Découvrez comment la nature évolue, comment la préserver et l'observer.
